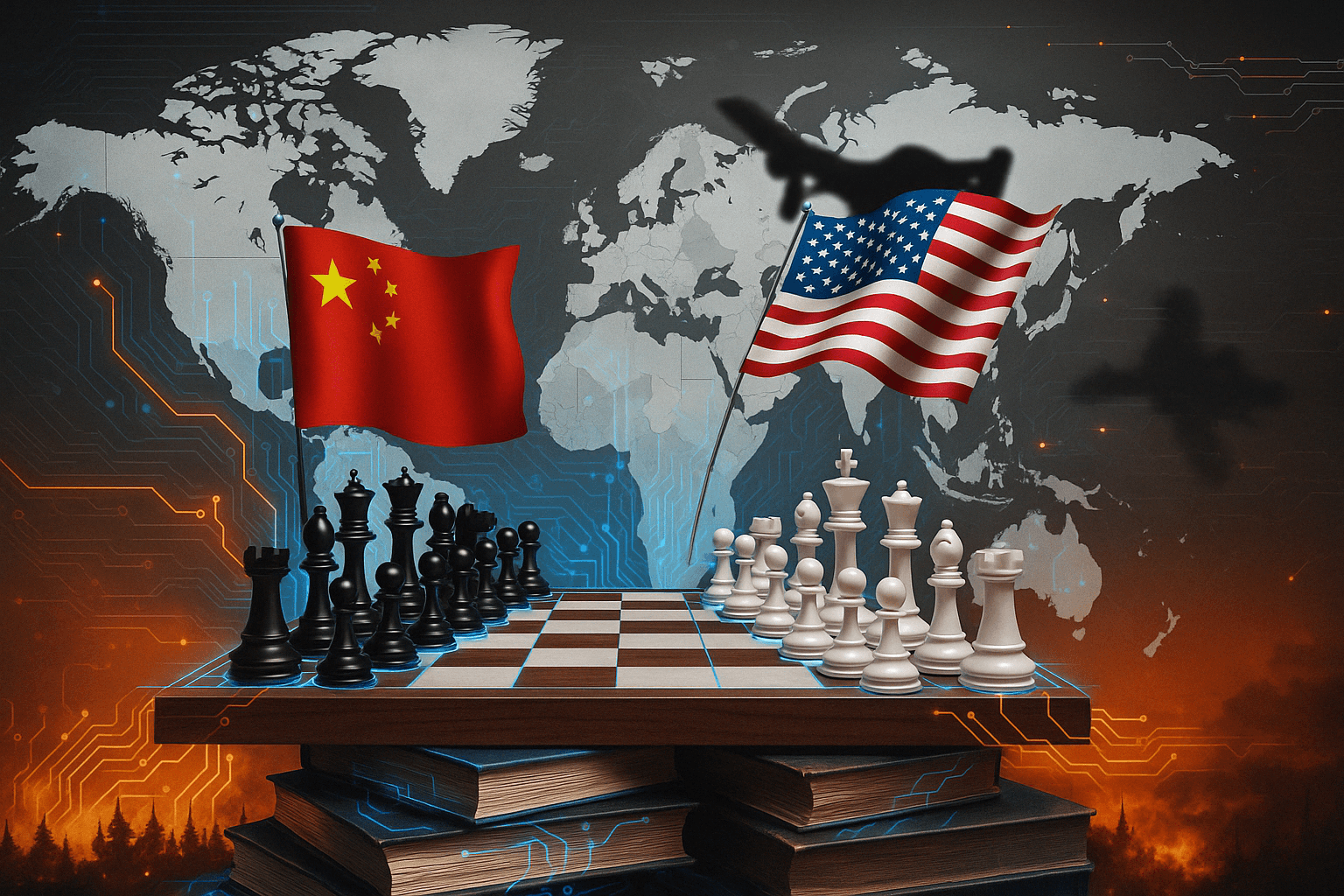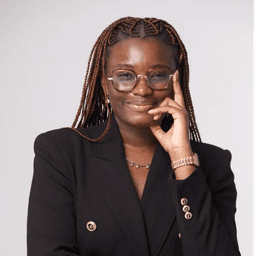Depuis 2017, la guerre commerciale et technologique entre Washington et Pékin s’est traduite par une succession de mesures protectionnistes : hausses massives de droits de douane, contrôles des exportations, restrictions d’accès au marché pour les entreprises technologiques. En 2025, ce bras de fer atteint un nouveau sommet, avec des taxes douanières américaines de 145 % sur les produits chinois, auxquelles la Chine répond par des droits de 125 % sur les biens américains. L’objectif affiché des États-Unis est de freiner l’ascension technologique chinoise et protéger la suprématie industrielle américaine.
Ce découplage a déjà coûté près de 150 milliards de dollars à la Chine en exportations perdues vers les États-Unis, tout en poussant les entreprises américaines à diversifier leurs sources d’approvisionnement, notamment vers le Mexique, Taïwan et le Vietnam. Pourtant, l’interdépendance reste forte : 30 % des machines de fabrication de semi-conducteurs exportées par les États-Unis sont toujours destinées à la Chine, et une large part des composants électroniques importés par les Américains provient encore, directement ou indirectement, de l’Empire du Milieu.
L’intelligence artificielle, nouveau terrain de confrontation
L’intelligence artificielle (IA) cristallise les tensions. La Chine, qui investit massivement dans le secteur depuis plusieurs années, ambitionne de dépasser les États-Unis et multiplie les innovations, à l’image de la sortie récente de DeepSeek, une IA concurrente directe d’OpenAI. Pékin bénéficie d’un soutien étatique massif, d’un accès quasi illimité aux données et d’une politique industrielle volontariste. Les entreprises chinoises, les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi), investissent près de 6 milliards de dollars dans l’IA, tandis que l’État a injecté 70 milliards d’euros dans la recherche entre 2019 et 2020.
Face à cette montée en puissance, Washington renforce ses sanctions, interdit la vente de microprocesseurs avancés à la Chine et nomme des personnalités du secteur technologique à des postes stratégiques. Les États-Unis accusent également la Chine de cyberattaques, comme celle qui a visé le Trésor américain en janvier 2025, et dénoncent les subventions massives accordées à l’industrie technologique chinoise.
Semi-conducteurs et électronique : la bataille des chaînes d’approvisionnement
Les semi-conducteurs sont au cœur de la rivalité. La Chine, premier marché mondial, ne produit que 16 % de ses puces et dépend encore des technologies américaines et taïwanaises. Le plan « Made in China 2025 » vise à combler ce retard, mais les sanctions américaines sur des entreprises comme Huawei ou ZTE freinent son développement. De leur côté, les États-Unis cherchent à rapatrier une partie de la production et à sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement, tout en continuant à tirer d’importants bénéfices du marché mondial de l’électronique.
Les restrictions américaines ciblent désormais les semi-conducteurs haut de gamme et les équipements nécessaires à leur fabrication, privant la Chine d’éléments clés pour ses technologies d’avenir, notamment l’IA et les supercalculateurs. Ces mesures s’appliquent aussi aux entreprises étrangères utilisant des technologies américaines, étendant ainsi la portée des sanctions.
Vers une fragmentation de l’industrie mondiale ?
L’avenir de la rivalité sino-américaine pourrait conduire à une fracture technologique globale. Deux écosystèmes distincts pourraient émerger : l’un dominé par les États-Unis et leurs alliés, l’autre par la Chine, forçant entreprises et pays à choisir leur camp. Cette fragmentation augmenterait la complexité des échanges, limiterait l’accès aux marchés et rendrait la concurrence plus imprévisible.
Quelles répercussions pour les pays africains ?
La rivalité technologique sino-américaine a des conséquences majeures pour les pays africains, qui se retrouvent au cœur de cette nouvelle « guerre froide » numérique. Beaucoup de nations africaines dépendent fortement des investissements et des infrastructures numériques chinois, notamment pour le déploiement de la 5G, des centres de données ou encore des réseaux de surveillance intelligente. Cependant, face à la pression américaine pour limiter la coopération technologique avec Pékin, ces pays se retrouvent confrontés à des choix stratégiques complexes, entre accès à l’innovation, sécurité de leurs infrastructures et indépendance numérique. Cette situation peut freiner leur développement, accentuer leur vulnérabilité aux ingérences extérieures et renforcer leur dépendance vis-à-vis d’un acteur unique. Pour de nombreux pays africains, il s’agit d’un enjeu de souveraineté et de développement à long terme.
En conclusion…
La rivalité technologique entre la Chine et les États-Unis s’inscrit désormais dans la durée, avec des conséquences majeures pour l’économie mondiale. Si l’interdépendance demeure, la tendance au découplage et à la fragmentation s’accélère, annonçant une nouvelle ère de compétition où innovation, sécurité et souveraineté technologique seront les maîtres-mots. Cette compétition façonne déjà les futures dynamiques géopolitiques et économiques mondiales, et impacte profondément les stratégies des États, des entreprises et des régions du globe.