Diplômé en comptabilité et gestion, Allan Abessolo n’était pas destiné à devenir créateur de contenu. Pourtant, depuis 2023, ses vidéos documentées et accessibles cumulent près de 3 millions de vues. En mêlant rigueur et pédagogie, il aborde des sujets sensibles de l’histoire et de la société gabonaise et africaine en général, offrant une alternative aux médias traditionnels. Rencontre avec un jeune vidéaste qui entend contribuer à écrire une mémoire collective, tout en jonglant avec les contraintes de la liberté d’expression au Gabon.
Peux-tu nous raconter ton parcours avant YouTube ? Qu’est-ce qui t’a donné envie de prendre la caméra pour partager tes idées et ta vision ?
J’ai grandi à Libreville, dans le quartier Sotega, et j’ai étudié à l’Institution Immaculée Conception. Après avoir obtenu mon baccalauréat série B en 2018, j’ai passé une année à l’université Omar Bongo. Mais très vite, je me suis rendu compte que ce n’était pas la voie qui me convenait.
J’ai alors décidé de partir en France pour entreprendre un diplôme de comptabilité et de gestion, avec le projet de devenir expert-comptable. La première année de mon arrivée a coïncidé avec le confinement, que j’ai dû traverser comme tout le monde.
C’est à cette période que l’un de mes grands frères, déjà installé en France et avec qui je parlais beaucoup de football, m’a proposé de regarder un documentaire sur le Gabon et la France-Afrique. Ce documentaire a été un véritable déclic : c’est à partir de ce moment-là que j’ai commencé à m’intéresser à ce type d’histoires.
En réalité, tout est parti de là. Sans ce moment précis, je ne me serais probablement jamais intéressé à ces sujets et je n’aurais jamais commencé à créer du contenu. Et là, je vous parle de l’année 2020.
Comment as-tu appris à créer du contenu (montage, son, image) et quelles ont été tes plus grandes difficultés techniques au début ?
J’ai appris à monter mes vidéos tout seul. Au départ, j’ai simplement utilisé le premier logiciel de montage qui se trouvait sur mon ordinateur : un logiciel gratuit de Windows, pas vraiment performant. Comme je ne connaissais rien au montage, je me suis lancé avec cet outil très basique, mais qui avait l’avantage d’être simple d’utilisation.
En réalité, ce n’était pas le montage qui posait le plus de difficultés au début, mais bien l’expression orale devant la caméra. Parler en public n’a jamais été un vrai problème pour moi, mais s’adresser à une caméra, c’est totalement différent. C’est un exercice assez particulier, surtout quand il s’agit de traiter des sujets où il faut donner des dates, des personnages et des événements précis.
Je me souviens que la toute première fois où j’ai essayé de tourner, je n’ai pas réussi. J’ai dû arrêter et recommencer le lendemain. Pour moi, c’était clairement ça le plus difficile : réussir à être naturel devant la caméra tout en restant précis.
Au Gabon, la liberté d’expression peut parfois être balayée d’un revers de main par les autorités. En tant que créateur, est-ce que tu t’imposes parfois des limites dans tes sujets ? Comment gères-tu cette réalité et la pression qui peut aller avec ?
Malheureusement, c’est une réalité de notre pays, et j’essaie toujours d’en tenir compte. Si je ne prenais pas ce paramètre en considération, mes vidéos paraîtraient sans doute beaucoup plus choquantes. Mais, comme on dit, on se fixe souvent certaines limites et on essaie de mettre des formes.
Par exemple, dans certaines vidéos, les informations que je traite peuvent être sensibles. Dans ces cas-là, j’utilise le droit ou les procédures judiciaires comme angle pour mettre en lumière certains faits. Cela permet d’apporter une légitimité et de rester dans un cadre plus neutre.
Mais il est vrai que ce n’est pas toujours évident. Quand on a un contenu comme le mien, on est souvent obligé de s’auto-censurer, de supprimer certaines parties qu’on estime trop sensibles et qui risqueraient de déplaire aux autorités.
J’avoue que depuis le 30 août, je continue à pratiquer une forme de censure, mais beaucoup moins qu’avant. Donc, oui, c’est toujours un problème présent, mais la situation avance un peu mieux.
Penses-tu que YouTube puisse offrir un espace plus libre que les médias traditionnels pour aborder des problématiques sociales, politiques ou culturelles au Gabon ?
Justement, c’est tout l’objectif de ma création de contenu : proposer quelque chose que les médias traditionnels ne mettent pas en avant. Que ce soit sur les problématiques socio-culturelles ou politiques, c’est là que se situe le but final de mon travail.
J’espère vraiment qu’on y parviendra, car on essaie d’avancer étape par étape, sans brûler les étapes. D’ailleurs, l’année qui arrive sera marquée par pas mal d’innovations et de changements dans la création de contenu sur ma chaîne. On verra bien comment les choses évolueront.
YouTube prend une place grandissante comme source d’information et de divertissement. Selon toi, en quoi cette plateforme peut-elle transformer le paysage médiatique au Gabon et en Afrique ?
YouTube a le potentiel de transformer le paysage médiatique en Afrique, y compris au Gabon. La plateforme offre à chacun la possibilité de prendre la parole, à tout moment et sous différentes formes.
Dans un système où les médias traditionnels sont souvent contrôlés ou limités, YouTube offre la possibilité aux créateurs de contenu d’aborder des thématiques qui ne sont pas forcément traitées à la télévision. Cela ouvre aussi un véritable espace d’expression et de débat sur des sujets variés.
On le voit déjà en France, où de nouveaux créateurs concurrencent les médias classiques. Je pense par exemple à Hugo Décrypte, qui est devenu une référence médiatique non seulement en France mais aussi dans le monde francophone. Alors pourquoi ne pas imaginer la même dynamique en Afrique ?
Beaucoup d’Africains dénoncent le fait que notre histoire est souvent racontée par d’autres. Est-ce que tu vois YouTube comme un outil pour rétablir un récit africain par les Africains, notamment sur des pans d’histoire occultés par nos systèmes éducatifs ?
En réalité, je ne pense pas que ce soit absolument à l’Africain de raconter son histoire lui-même. Si je fais le constat des thématiques que j’aborde, notamment les combats post-indépendance, ce n’est pas toujours une opposition entre Africains et Européens, ni entre Gabonais et étrangers. La vraie question, c’est comment l’histoire est racontée et traitée.
L’histoire du Gabon a très souvent été racontée par ceux qui en ont profité : ceux qui ont pris le pouvoir à l’indépendance et ceux qui l’ont conservé ensuite. Et ces personnes-là, dans la majorité des cas, ce sont des Gabonais. Quand on regarde les ouvrages existants, on trouve beaucoup de livres écrits par des Gabonais, mais qui ne disent pas toujours toute la vérité sur notre histoire.
Je vais prendre un exemple : Gabon 20 ans, un livre écrit par un Gabonais (Ovono-Essono Jean). Pourtant, ce n’est pas ce livre-là qui a marqué les esprits. Le livre qui s’est le plus vendu et qui a le plus dénoncé certaines réalités a été écrit par un Français. Et personnellement, cela ne me dérange pas qu’un Français raconte l’histoire du Gabon, tant qu’il la raconte dans son ensemble : avec ses moments de gloire, mais aussi avec ses faiblesses.
Pour moi, ce n’est donc pas une question de nationalité de l’auteur. D’ailleurs, il est souvent plus difficile pour un Gabonais de raconter son histoire, car il vit avec la crainte des conséquences que cela pourrait entraîner.
Concernant nos systèmes éducatifs, c’est beaucoup plus compliqué. Et là, pour le coup, je ne comprends pas la démarche. Je ne comprends pas pourquoi on ne met pas en avant l’histoire de notre pays dans nos écoles.
On gagnerait tellement à enseigner notre histoire : cela permettrait de former des patriotes, des citoyens conscients, en leur apprenant le parcours de ceux qui ont façonné le Gabon dans le bon sens. Mais aujourd’hui, on n’enseigne pas ou très peu l’histoire du Gabon à l’école, et je ne comprends vraiment pas cette logique.
Un peuple instruit, conscient des réalités de son pays grâce à son histoire, est beaucoup plus à même de défendre ses intérêts. Or, de manière générale, en Afrique et dans les grandes dictatures, les dirigeants n’ont pas intérêt à ce que les citoyens soient conscients des véritables enjeux politiques de leur pays. On préfère détourner leur attention vers autre chose.
À ton avis, quels sont les avantages et les limites de YouTube par rapport aux autres réseaux sociaux pour créer, informer et éduquer ?
L’un des avantages de YouTube, c’est qu’on peut y informer et aborder certains sujets en profondeur. En général, quand les gens vont sur YouTube, c’est qu’ils ont du temps devant eux. D’ailleurs, près de 40 à 50 % de mes vidéos sont regardées sur des télévisions, et ces spectateurs-là, en général, vont jusqu’au bout du contenu.
C’est quelque chose de plus difficile à obtenir sur un réseau comme TikTok, où les utilisateurs scrollent très vite et n’ont pas forcément la patience pour des formats longs. Par contre, TikTok a l’avantage de toucher plus facilement de nouvelles personnes grâce à son algorithme. Sur YouTube aussi, une vidéo peut très bien marcher et attirer un nouveau public, mais ce n’est pas aussi simple ni aussi systématique que sur TikTok.
Tu es suivi par une génération connectée qui cherche à s’informer autrement. Comment perçois-tu ta responsabilité en tant que créateur auprès de ta communauté ?
Ça, c’est vraiment une question personnelle, parce que c’est quelque chose auquel je fais attention depuis le tout début. J’essaie de varier et de multiplier mes sources pour avoir plusieurs versions d’un fait et ainsi donner un résultat le plus juste et neutre possible à ma communauté.
Et cela, je le fais depuis mes 70 abonnés jusqu’à mes 50 000 aujourd’hui sur YouTube. On essaie toujours de faire attention à ce qu’on dit. Et si jamais on se trompe, il ne faut pas hésiter à corriger, à reprendre, ou à signaler à sa communauté : « À tel moment je me suis trompé, la bonne information c’est plutôt ça. »
C’est ça, en réalité, la responsabilité que je m’impose à moi-même.
Comment fais-tu pour maintenir le lien et l’interaction avec tes abonnés dans la durée ?
Pour l’instant, le principal lien qui me maintient avec ma communauté, puisque je ne fais pas énormément de lives, c’est mon dynamisme sur YouTube et sur les autres plateformes. Comme le contenu YouTube demande beaucoup plus de temps à produire, j’essaie de publier régulièrement sur ma chaîne, tout en partageant de temps en temps des TikTok ou des posts sur Facebook, afin de garder un lien constant avec ma communauté.
Si tu devais donner une seule clé à un jeune Gabonais qui rêve de se lancer sur YouTube, laquelle serait-elle : la créativité, la régularité, le courage de dire les choses… ou autre chose ?
Pour réussir sur YouTube, je pense qu’il n’y a pas une seule clé, mais s’il fallait en retenir une, ce serait d’apporter une valeur ajoutée.
Je m’explique : à chaque fois que je prépare une vidéo, depuis mes débuts, je me pose toujours la même question : « Qu’est-ce que je peux apporter à celui qui va regarder cette vidéo ? » Dans ma communauté, il y a des gens qui connaissent déjà très bien l’histoire du Gabon. Je pars donc du principe que même eux doivent apprendre quelque chose de nouveau grâce à mon contenu.
C’est pour cela que, lorsque je traite un sujet largement abordé sur les réseaux sociaux, comme par exemple le génocide au Rwanda, je m’efforce d’apporter des informations ou une méthodologie différente de ce qu’on peut retrouver dans les centaines de vidéos déjà existantes sur ce thème. C’est cette démarche qui me permet de me distinguer.
Mais bien sûr, pour réussir sur YouTube, il faut aussi de la régularité, de la patience, et une certaine exigence. Il ne suffit pas de travailler uniquement le fond : la forme est tout aussi importante. Une bonne caméra, un bon micro, de bonnes images… tout cela participe à la qualité du contenu et à l’expérience du spectateur.




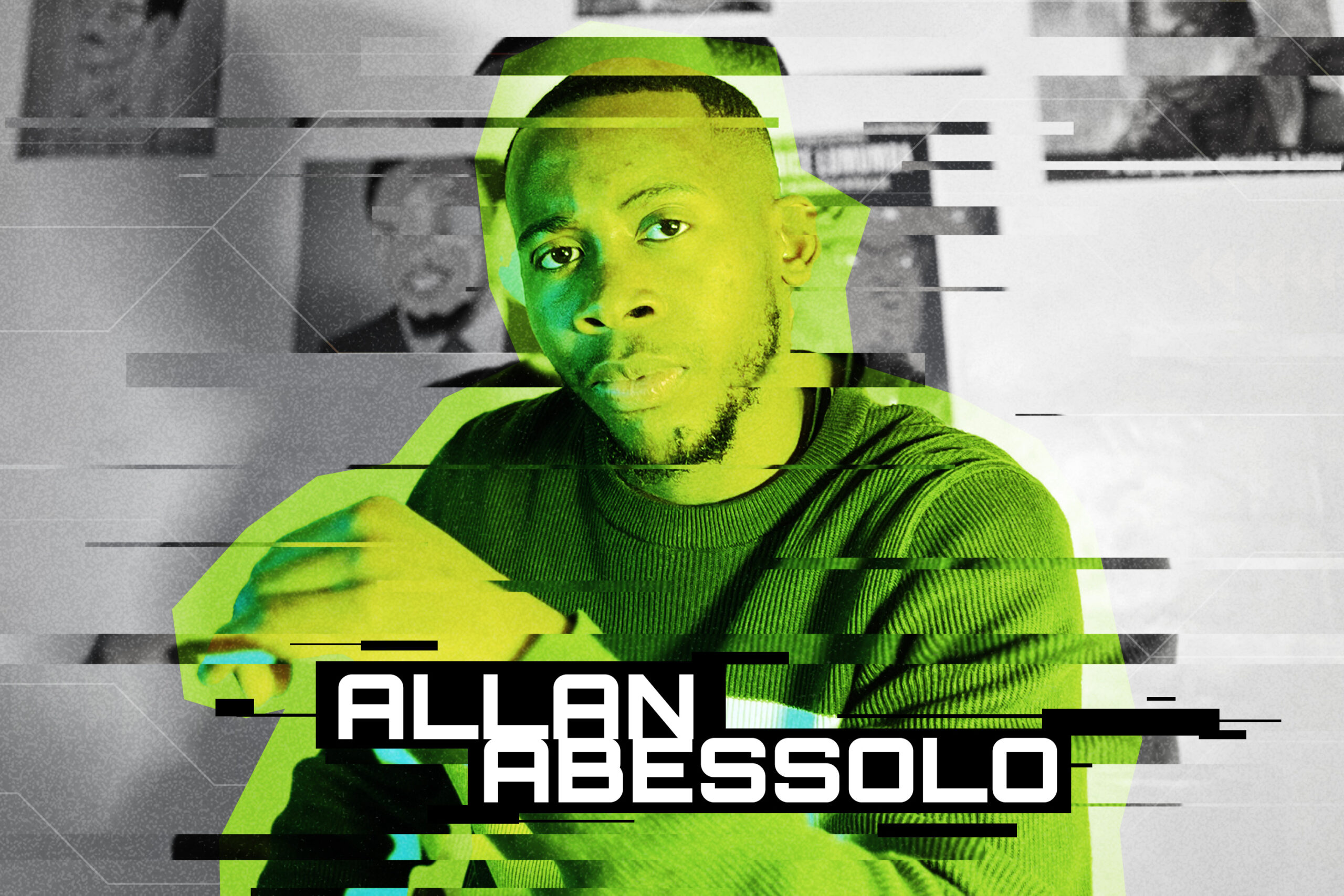
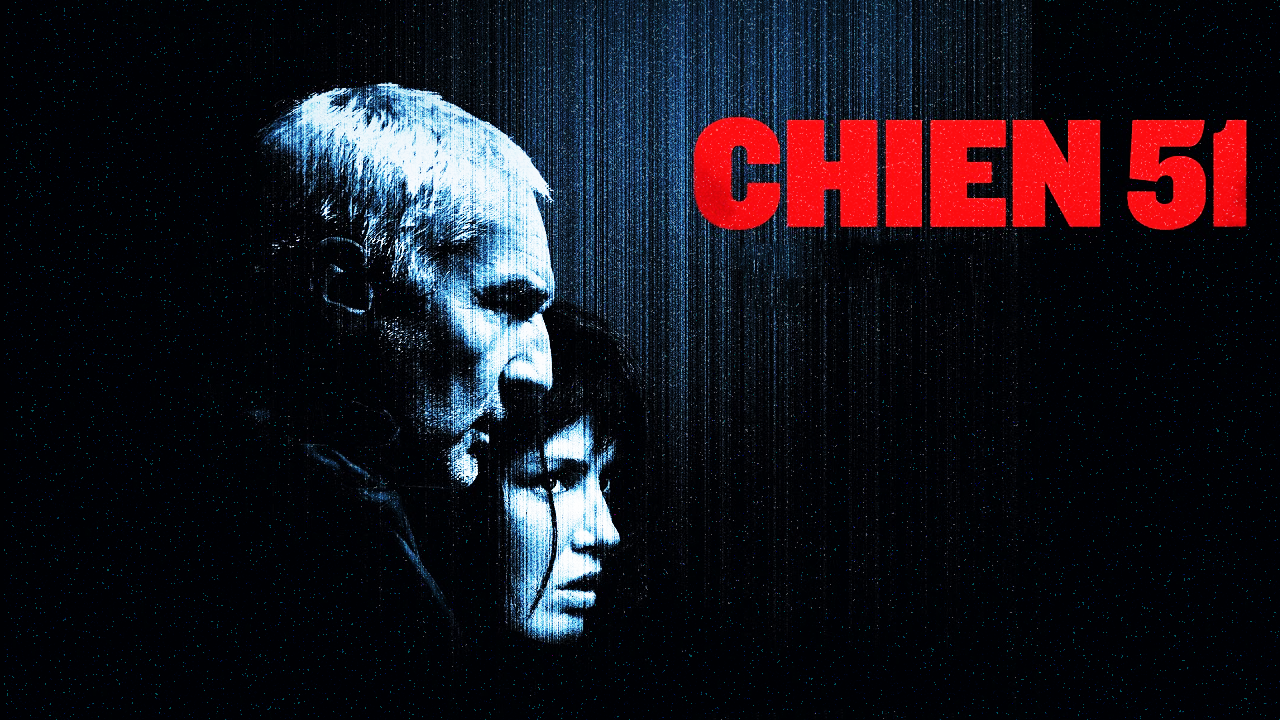

![[TRIBUNE CYBERSECURITE] – Contribuer à la souveraineté numérique du Gabon : vers une Agence de Cybersécurité – Didier SIMBA](https://techies.ga/wp-content/uploads/2025/10/WhatsApp-Image-2025-10-23-at-10.39.41.jpeg)







