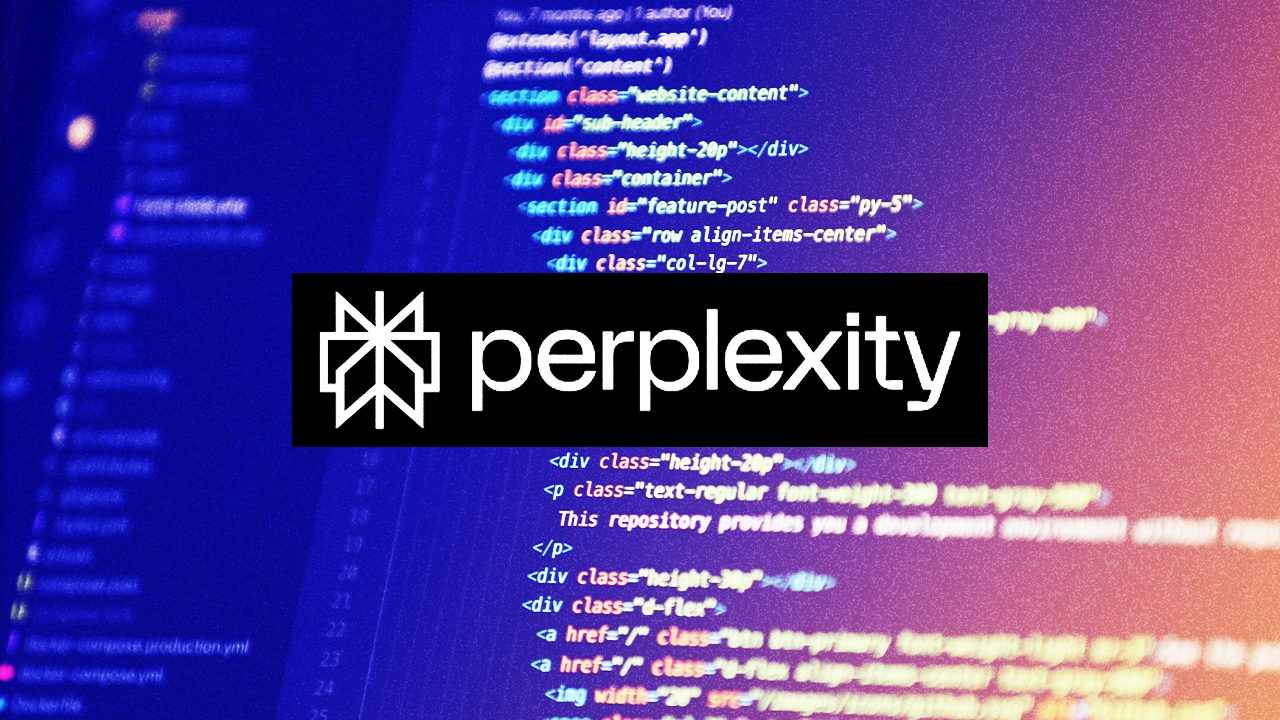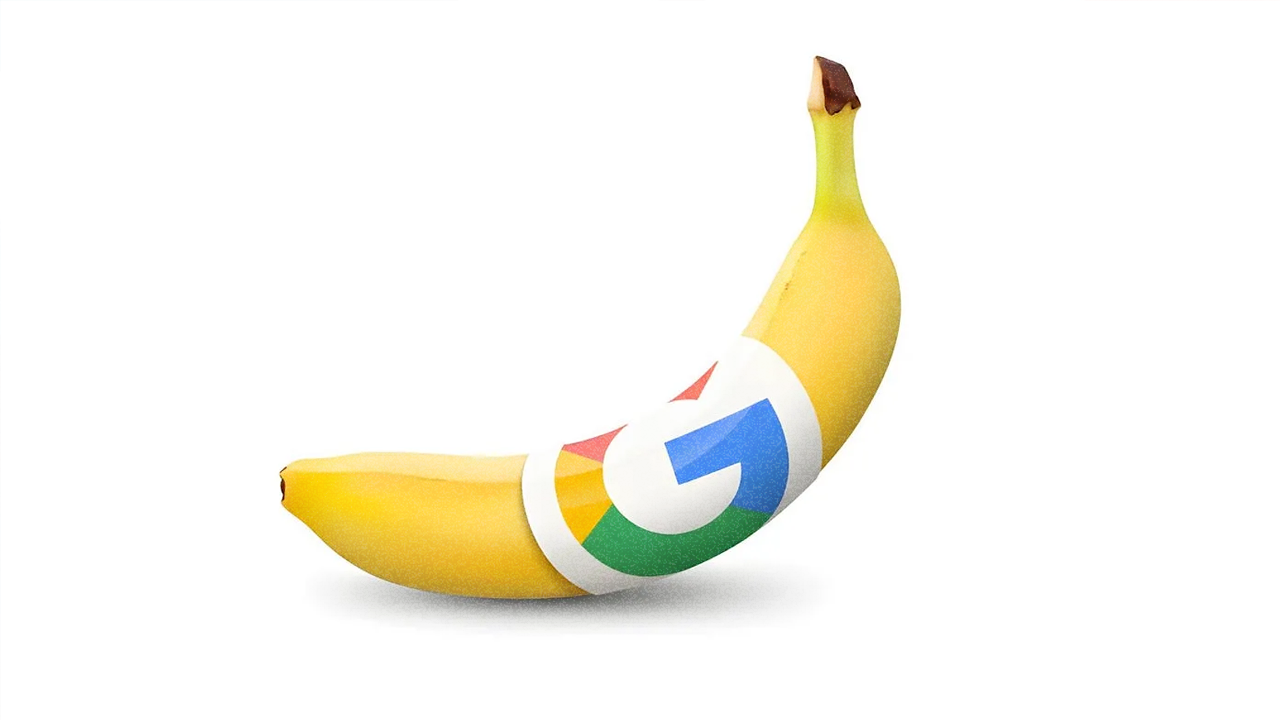Issu de l’argot drag afro-américain, tea désigne vérité ou potin. La formule “body tea” s’est popularisée après une phrase virale sur les réseaux : « Her body tea, she’s super thick… ». Interprétée comme « She has body tea », elle signifie : son corps mérite d’être remarqué.
En Afrique, on retrouve ce terme dans des légendes TikTok ou Instagram. Plus qu’un compliment, il devient une manière de mettre en avant une apparence conforme aux standards du moment.
L’homme performatif : posture et surjeu en ligne
À côté du “body tea”, une autre figure émerge : celle de l’“homme performatif”. C’est un internaute qui adopte des postures très visibles — virilité surjouée, engagement féministe affiché, style de vie ostentatoire — mais souvent sans profondeur réelle.
Son but ? Soigner son image et recueillir validation numérique. Sa performance tient moins à ce qu’il fait qu’à la façade qu’il expose.
Afrique connectée, tendances globalisées
Même si l’expression n’est pas encore étudiée en contexte africain, les comportements associés à l’homme performatif se retrouvent sur les réseaux du continent. Dans les grandes villes, de nombreux influenceurs masculins affichent corps musclés, réussite financière et signes extérieurs de richesse. Tout comme le “body tea” valorise certains physiques féminins, l’homme performatif valorise sa masculinité en façade.
Pressions sociales et illusions numériques
Ces tendances révèlent un mécanisme commun : transformer le corps ou la posture en valeur sociale. Chez les femmes, le “body tea” peut encourager une certaine fierté corporelle mais aussi renforcer la pression de l’apparence. Chez les hommes, la performativité crée une illusion de virilité et de puissance, souvent éloignée des réalités quotidiennes.
La quête de validation numérique entretient des comparaisons constantes, nourrit des insécurités et fragilise la frontière entre être et paraître.
Un miroir global aux résonances locales
En Afrique, où les réseaux sociaux deviennent des espaces d’expression identitaire, ces pratiques traduisent une tension : entre désir de reconnaissance et reproduction de normes mondialisées. Que ce soit par le compliment “body tea” ou par la posture performative, l’image devient une monnaie sociale.
Conclusion : l’image comme scène de société
“Body tea” et “homme performatif” illustrent un phénomène de société : l’avènement de façades numériques qui pèsent sur l’estime de soi. Compliment, virilité, style de vie… autant de performances qui nous rappellent que, sur les réseaux, l’image n’est jamais neutre. Elle révèle autant qu’elle masque, dans un jeu permanent entre authenticité et illusion.